 Voici ma nouvelle nouvelle originale du mois de Janvier dans le cadre du challenge des Ecrinautes. Pour rappel, je produis 2 nouvelles par mois (quand je n’oublie pas de m’y consacrer) pour le challenge des Ecrinautes, une qui, pour l’instant, a un peu d’avance, car étant une nouvelle à chapitre, 4 sont déjà publié, donc encore 2 d’avance (enfin non, plus qu’une). L’autre, c’était celle-ci le mois dernier… (enfin le mois d’avant 😉 ), et c’est ce qui suit ce mois-ci. J’ai eu du mal à trouver l’inspiration. Mais j’avais envie de raconter une histoire façon « Dossiers extraordinaires » de Pierre Bellemare. La voici donc, même si, contrairement à Pierre Bellemare, mon histoire est une pure fiction.
Voici ma nouvelle nouvelle originale du mois de Janvier dans le cadre du challenge des Ecrinautes. Pour rappel, je produis 2 nouvelles par mois (quand je n’oublie pas de m’y consacrer) pour le challenge des Ecrinautes, une qui, pour l’instant, a un peu d’avance, car étant une nouvelle à chapitre, 4 sont déjà publié, donc encore 2 d’avance (enfin non, plus qu’une). L’autre, c’était celle-ci le mois dernier… (enfin le mois d’avant 😉 ), et c’est ce qui suit ce mois-ci. J’ai eu du mal à trouver l’inspiration. Mais j’avais envie de raconter une histoire façon « Dossiers extraordinaires » de Pierre Bellemare. La voici donc, même si, contrairement à Pierre Bellemare, mon histoire est une pure fiction.
La vengeance est un plat qui se mange froid
« La vengeance est un plat qui se mange froid ». Ceci est la conclusion de notre histoire. Mais pour bien comprendre toute la profondeur et la véracité de cette assertion, il faut remonter le temps et nous intéresser à la vie presque sans histoire de Paul Carton. Il naquit en avril 1972, le 13, dans la banlieue parisienne, à Juvisy-sur-Orge. C’était un bébé qui pleurait abondamment dès qu’il n’était plus dans les bras de son père ou de sa mère. Ses parents l’aimaient, même si eux, après cette quatrième grossesse, commençaient à ressentir les tiraillements de la lassitude. Mais c’était une époque où la moindre difficulté dans un couple ne donnait pas immédiatement lieu à une séparation, et où l’avenir des enfants avaient finalement plus d’importance que le bonheur égoïste de l’union qui avait amené leurs conceptions. Et puis, sans se le dire vraiment, ni Mireille, née Garotin, ni Jacques ne pouvaient admettre après un quatrième enfant, qu’ils n’avaient plus aucune attache. Bien au contraire, à la naissance de Paul, quatrième garçon de leurs progénitures, quatrième déception pour Mireille qui espérait depuis toujours élever une fille, le renoncement à la vie de famille eut été bien trop brutal et opposé à leurs convictions issues d’une éducation classique d’après guerre.
Bébé Paul grandit donc, bien entouré, petit dernier, donc chouchou, du quatuor composé de Jean, de 5 ans son aîné, de Romuald, 3 ans plus âgé, de William, né un an plus tôt, et de lui-même. Toute tentative pour ajouter une fille à ces daltons de banlieue échoua tant par crainte d’en produire un cinquième, de Dalton, que parce que la vie de famille, source de tant de bonheur conjugal, s’avérait aussi plus difficiles pour le couple Carton. Dans un appartement où les deux frères les plus âgés partageaient la même chambre et regardaient avec jalousie la jouissance absolue de William, heureux et seul occupant de la seconde chambre, Mireille et Jacques Carton hébergeait dans leur propre chambrée surchargée le dernier lascar jusqu’à ce qu’il soit en âge de partager les murs de William sans risquer de le réveiller. Impossible de faire déjeuner toute la petite famille dans la petite cuisine, si bien que l’envahissante descendance occupait canapé et table du séjour à longueur de temps, sauf ceux qui allaient à l’école. Fort heureusement, cette époque bénie ne proposait que trois chaînes de télévision dont une seule à la fois retransmettait un programme accessible aux enfants, ce qui limitaient les disputes. Loin de constituer un réel problème, la petitesse de l’appartement était en relation directe avec les revenus du couple, dans lequel seul Jacques percevait salaire. Les allocations familiales constituaient un pécule dont les Carton n’auraient pu se passer et ce même si la feuille de paye du père de famille était relativement bien dotée.
Il fallut un peu plus de six ans après la naissance de Paul pour envisager l’amélioration de leurs conditions de vie. Mireille, libérée en partie du joug de l’éducation par son fils le plus âgé, chercha et trouva un emploi, et le couple envisagea, comme c’était une époque faste pour ça, de faire construire une maison. Ce qui fut dit fut fait. Sans se saigner aux quatre veines, les Carton emballèrent leurs affaires pour les poser un peu plus loin dans la campagne essonnienne à proximité d’Etampes où Jacques prenait le train chaque jour pour poursuivre son activité professionnelle parisienne. L’unique voiture du couple restait ainsi dans les mains de Mireille qui amenait et ramenait son mari de la gare matin et soir, et qui s’occupait de conduire les enfants à l’école et au lycée avant de prendre son poste de caissière à mi-temps au Leclerc du coin.
Ainsi furent les douces années de Paul Carton, qui eut son BAC C avec mention, fit ses études à Paris, partageant une chambre de bonne avec William, alors que ses plus vieux frères travaillaient déjà. Même si elle commençait à s’éparpiller aux quatre vents, la famille Carton restaient soudés, se voyaient tous les weekend, et rejoignaient les tribus familiales maternelles ou paternelles au moins une fois par trimestre avec pour seule excuse de se voir entre patriarches, matriarches, oncles et tantes prompts à prendre des nouvelles de la progénitures qu’ils avaient déjà choyés chaque Noël depuis 18 ans. Dix-huit ans fut l’âge de la majorité pour Paul, et l’occasion de fêter l’émancipation électorale du rejeton à défaut de sa maturité intellectuelle, professionnelle ou sexuelle.
Paul Carton décrocha un DEUG en Science de la Matière avant de s’orienter dans une carrière informatique courte, un simple DUT. S’il se fit reprocher d’avoir lâchement abandonné l’idée d’une filière plus honorable, dès lors que le mot « ingénieur » figurait sur l’emballage, on ne pouvait guère le houspiller de permettre à ses parents de faire les économies nécessaires pour payer les écueils estudiantins catastrophiques de William qui désespérait de remporter un diplôme BAC +2 dans une voie plus manuelle et finalement bien moins prestigieuse. Désespérait-il vraiment, par ailleurs ? Son cadet et ses aînés n’étaient pas dupe. Et ses parents non plus. William avait toujours été un cancre et un profiteur à qui la condition d’étudiant fêtard et sans soucis plaisait énormément.
Jean et Romuald étaient déjà mariés et le premier enfant de l’aîné poussait dans le ventre de sa femme quand Paul obtint son premier emploi, juste après avoir accompli ses obligations militaire durant 10 mois dans une caserne rennaise. Il avait trouvé une place dans une société de service en ingénierie informatique (SSII comme on disait à l’époque) dont le siège était situé à Orléans. S’il était heureux de fuir la vie stressante du métropolitain moyen, il le fut moins de mener sa première mission à la capitale où il se rendait chaque jour par le train, ce qui coûtait moins cher que de le loger à Paris durant la semaine. Loin de ses premiers émois estudiantins, sa première vraie rencontre de cœur eut lieue chez son client. Elle s’appelait Delphine Huron, et il ne parvint à lui adresser la parole que la dernière semaine de sa mission, pour découvrir qu’elle nourrissait elle-même un certain intérêt pour sa personne. Paul regretta par la suite de ne pas avoir tenté sa chance plus tôt, car son entreprise le confia à un autre client dans la région bordelaise, ce qui rendit très difficile la croissance de cette idylle naissante. Le coût en communication téléphonique devint même rapidement un obstacle à la continuation de cette relation qui mourut dans l’œuf après seulement trois rendez-vous galant parisien. La belle ne souhaitait apparemment pas faire l’effort de quitter la cité, et il n’était pas dans les moyens du jeune Paul que d’effectuer systématiquement à ses frais le déplacement.
Séparé de Delphine et cherchant la consolation chaque weekend dans la maison familiale, la mission bordelaise devint rapidement étouffante pour Paul Carton. Bien que son employeur lui ait fournit un véhicule de fonction pour le laisser libre de ses mouvements, passer chaque nuit seul dans un hôtel Première Classe commença à peser sur son moral. Il s’était fait quelques amis dans la société de service, des personnes qui vivaient à Orléans, sortaient le soir, et menaient une existence bien moins solitaire que lui. C’est sur le compte d’une petite dépression qu’il mit son accident de voiture. Un accident qui se produisit sur l’autoroute au niveau de Poitiers alors qu’il rentrait le vendredi soir après son labeur hebdomadaire. Paul avait précipité sa voiture contre la barrière de sécurité pour éviter un véhicule qui s’était, selon lui, rabattu trop près. Il s’en était sorti sans trop de mal. Son véhicule, une Mégane, était équipé d’airbags qui lui avaient évité un choc avec le pare-brise, tandis que le côté passager de l’habitacle avait diminué de 30 centimètres dans sa largeur et que sa Renault s’immobilisait le long de la rambarde après deux tours complets. C’était en avril 1998, et c’était le soir de son anniversaire…
Si Paul s’en sorti avec quelques égratignures il ne fut pas retiré de la mission bordelaise qui devint un calvaire cette fois, à cause de la nécessité d’utiliser les transports en communs. Son entreprise ne pouvait pas remplacer aisément la voiture perdue, même si les assurances en avait remboursé l’essentiel de la valeur résiduelle, ce n’était pas suffisant pour engager de nouveaux frais sur un véhicule de fonction dont la jeune entreprise ne disposait pas à loisir. Ce n’était pas suffisant non plus pour redonner confiance en leur employé qui l’avait détruite. Paul Carton n’eut d’autre choix que d’accepter sa peine jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus et demandât à son responsable de le retirer de cette mission pour quelque chose de moins pénible tant en terme d’isolement que de contraintes géographiques. Même si elle pouvait être légitime, les SSII n’étaient pas tendre avec les employés qui faisaient la fine bouche et les difficultés que l’entreprise eut à faire remplacer Paul chez ce client qu’ils ne pouvaient pas perdre, rejaillirent sur son dossier.
Un petit mois d’inter-contrat fut nécessaire pour replacer le triste Paul Carton, sur Paris à nouveau. Comme l’entreprise avait missionné plusieurs prestataires dans la région, elle louait un appartement à Meudon pour les y loger en semaine, ce qui leur coûtait beaucoup moins cher en frais de transport et de logement à dégrever de leur marge. Paul avait espéré renouer avec Delphine, mais y renonça et se contenta d’accomplir sa nouvelle charge en se plaignant le moins possible. Revenir à Paris lui permit de retrouver plus souvent des membres de sa famille, notamment son frère William qui travaillait en tant que serveur dans un bar obscur de Boulogne-Billancourt. Il se permit même de rester certains weekend dans le vaste appartement de fonction pour profiter des joies parisiennes et reprendre un peu goût à la vie. Ce soir en semaine d’avril 1999 où il se rendit au bar de son frère pour fêter son anniversaire avec quelques rares collègues côtoyés chez son client et dans l’appartement de fonction, fut assez marquant lui aussi. Car en arrivant dans l’étroite rue où clignotait l’enseigne du Twister, une voiture le percuta et le renversa. Ses amis avaient évité de justesse de subir le même sort que lui et appelèrent aussitôt les secours. L’un d’eux avait eu la présence d’esprit de noter le numéro de plaque de la voiture qui ne s’était pas arrêtée.
Paul Carton s’offrit bien malgré lui un séjour à l’hôpital. Il souffrait d’une commotion cérébrale des suites d’une fracture du crâne, avaient deux côtes fêlées et un bras cassé. Il fut visité par tellement de membre de sa famille qu’il en perdit le compte durant son mois de convalescence. Entre temps, et tout naturellement dans les sociétés de service, son employeur avait pourvu à son remplacement dans la mission qu’il menait à Paris. Ce fut donc d’un prompt retour à Orléans, et en inter-contrat, pour ne pas changer, que son rétablissement fut suivi. Et bien qu’il n’ait aucune responsabilité dans ce qui lui était arrivé, la SSII n’était pas disposée à lui faire de cadeaux pour le manque à gagner de ce second abandon involontaire de poste. L’entreprise ayant des ambitions à l’international était parvenu à décrocher un client au Maroc et Paul Carton fut donc en première ligne pour s’y rendre. Il demanda à réfléchir, car il s’agissait cette fois, compte-tenu des distances, d’un retour en France tous les deux mois au mieux pour une mission qui promettait de durer au moins un an.
Paul n’était pas à l’aise avec l’idée de vivre à l’étranger, même dans un pays largement conquis par la francophonie. Mais sentant qu’il n’avait que le choix de dire « oui » ou de perdre son emploi, il accepta. Ce fut difficile. Car Paul peina à se faire des amis sur place, et demeura isolé, ne vivant chaque heure que pour la soirée qui se trouvait au bout, chaque semaine que pour le weekend qui l’en libérait et chaque mois que pour ce petit séjour d’un bref retour en France où il préférait rendre visite à ses parents que retourner voir ses quelques amis orléannais et son appartement vide et froid. Ce Noël 1999 fut bien mouvementé avec cette tempête dont les dégâts paralysèrent la moitié nord de la France, ce qui eut un impact imprévu sur les vols en partance pour le Maroc et permit à Paul de rester un peu plus longtemps dans la maison familiale. L’occasion de revoir ses frères et ses neveux et nièces qui poussaient loin de lui. Même William avait trouvé une compagne, ce dont il se vantait bien qu’il n’ait pas osé l’inviter pour les fêtes. Cela rappelait à Paul la triste solitude dans laquelle il vivait.
Encore deux voyages de plus et un petit retour en France à l’occasion de son anniversaire menèrent Paul à accepter l’invitation de son aîné dans sa maison pour y fêter ses 28 ans. Le jeune homme fut heureux de retrouver Jean, sa femme et de ses enfants, turbulents, certes, mais d’agréable compagnie. Il n’aurait pas forcément été dérangé par une autre forme de célébration, mais après un an de mission à l’étranger, il avait perdu de vue la plupart de ses relations locales, et il n’avait pas tellement envie de prendre des risques étant donné la manière dont ses deux derniers anniversaires s’étaient terminés. D’ailleurs, ce soir-là avec Jean, en train de discuter devant la télé pendant que les enfants jouaient et que l’épouse Carton était en cuisine, il évoqua ces accidents en réalisant seulement aujourd’hui la coïncidence :
– C’est maintenant que tu remarques ça ?, lui dit Jean un sourire moqueur aux lèvres.
– Je dois reconnaître que j’avais un peu la tête ailleurs ces deux dernières années, avoua Paul.
– On s’est tous dit que ce n’était pas de chance quand même.
– Qui ça « on » ?
– Ben, la famille quoi. Désolé, mais on en a parlé entre nous à différentes occasions.
– Oui, bien sûr. Sauf avec moi.
– Quelle importance ?
Certes, ça n’en avait aucune, songea Paul. Et même, ça n’était qu’une coïncidence et il n’y avait rien d’autre à en dire. Et puis s’il avait dû se passer à nouveau quelque chose cette année, ça aurait déjà dû arriver. La petite famille se coucha et Paul, seul dans la chambre d’ami, ressassa les souvenirs de ces malheureux accidents et s’endormit légèrement barbouillé.
La maisonnée de Jean Carton ne passa pas la nuit dans le calme. Il fallut appeler le SAMU et hospitaliser d’urgence tout le monde pour intoxication alimentaire. Ce fut même assez grave pour engager le pronostic vital de Gaëlle, la dernière née de 5 ans de Jean, qui se remit avec peine. Et durant cette nuit abominable, durant ce séjour aux urgences, aux pires moment de cet abject lavement d’estomac, et après, dans ce lit, si nauséeux qu’il avait constamment envie de vomir tripes et boyaux, Paul ne cessa de penser qu’il ne s’agissait plus d’une coïncidence, que l’on en voulait à sa vie à sa date d’anniversaire, et qu’on ne reculait devant rien pour le supprimer.
Il n’en dit rien à Jean et l’on mit l’intoxication sur le compte d’un aliment au conditionnement altéré comme il pouvait y en avoir parfois. Mais dans la tête de Paul, c’était un empoisonnement. Dès qu’il put sortir de l’hôpital, son premier réflexe fut d’aller voir la gendarmerie, mais il eut beau faire part de ses doutes et raconter son historique, il se vit dire qu’il n’y avait aucun moyen de vérifier, après tout ce temps, qu’il ait été victime d’un forcené. Et si ses deux accidents corporels pouvaient avoir semblé suspect, il n’en était rien de cette intoxication. Paul n’eut guère le temps de défendre son bout de gras, car il devait retourner travailler. Sa société lui avait demandé de se présenter au siège orléannais pour faire le point. Une manière polie de dire que ses séjours hospitaliers récurrents nuisaient à la continuité et au sérieux de sa prestation, où qu’il aille. D’ailleurs, son employeur s’était empressé de le faire remplacer au Maroc et lui avait signifié qu’il allait lui chercher autre chose avec un tel manque de conviction dans le ton qu’il ne faisait aucun doute que la demande de son patron d’assumer, sous forme de congés payés, une partie de son inter-contrat voulait dire qu’on le mettait sur une voie de garage et qu’une compression de personnel inopinée risquait fort de lui coûter son job.
Mais Paul ne s’en offusqua pas. Il accepta même de rattraper nombre de ces journées de congés parfois difficiles à prendre et reconduites depuis l’année civile précédente pour s’offrir un petit mois de vacances. Il ne tenait plus en place et n’en pouvait plus d’imaginer qu’un individu venait de menacer la vie d’une de ses nièces en essayant de le tuer, qu’il avait déjà tenté de l’occire ces deux dernière années à sa date d’anniversaire et que personne ne risquerait de croire une telle fable. Il voulait utiliser ce temps libre pour mener lui-même l’enquête. Du moins, il réalisa très vite que contrairement à tous les feuilletons américains, l’emploi d’un détective privé n’était ni aisé à obtenir, ni tout à fait dans son budget, raison pour laquelle il se mit en tête de trouver lui-même sa Némésis. Mais tout ce qu’il fit durant ce mois-là ne mena à rien ou presque. Il n’avait tout simplement aucune piste et avait beau essayer de se remémorer les événements, il ne parvenait pas à dégager le moindre détails qui aurait pu l’aider. Ce n’est qu’au terme de ses congés qu’il songea qu’il n’était pas seul, l’an dernier, lorsqu’il s’était fait renversé par la voiture à Paris et que ceux qui l’accompagnaient à ce moment avaient peut-être vu quelque chose d’intéressant. Et ce fut le véritable point de départ probant de sa traque.
De retour à son agence orléannaise, Paul Carton commença à se comporter bizarrement. Ce n’était pas tant le fait d’être contraint à travailler à l’agence, même sur une mission de peu d’intérêt, mais plutôt l’idée que celui ou celle qui lui en voulait hantait peut-être les mêmes murs que lui. Alors il regardait tout le monde de biais, refusait les propositions d’aller déjeuner en groupe, et répondait avec méfiance ou pas du tout à toute question qu’il jugeait le concerner personnellement et sans rapport avec le travail. Et pendant ce temps, il attendait des nouvelles du plus jeune de ses frères qui devait lui communiquer les adresses email ou les numéros de téléphone des personnes qui se trouvaient avec eux le soir de l’accident. Et surtout, il réfléchissait. Il s’interrogeait sur le « pourquoi ». Car il se demandait bien ce qu’il avait pu faire pour qu’on lui en veuille à ce point. Et bien sûr, il s’imaginait tout et n’importe quoi, mais rien qui puisse justifier qu’on cherchât à l’éliminer.
Lorsqu’il fit le tour des contacts récupérés par William, l’un d’eux, un dénommé Jacques Maurice, lui révéla qu’il avait effectivement relevé le numéro de plaque d’immatriculation de la voiture qui l’avait renversé. Et comble de la chance, il l’avait gardé. Paul s’en voulait de ne pas s’être intéressé plus tôt au problème. Le conducteur avait effectivement pris la fuite et Paul n’avait pas pensé à le poursuivre. Il n’était certes pas en état de le faire à l’époque, mais personne n’avait pris le relais. William s’en voulait trop pour affoler les parents ou pour oser faire la démarche lui-même, et l’on avait fait passer l’hospitalisation de Paul pour un banal accident. Plus d’un an après les faits, la visite du cadet Carton au commissariat ne donna aucune suite. Tout d’abord, on ne prit pas tellement son affaire au sérieux et surtout, on lui serina qu’on ne venait pas porter plainte sur un fait remontant à aussi loin dans le cadre d’un accident corporel. Confiant, Paul avait réclamé qu’on consulte le fichier des immatriculations pour lui, afin qu’il puisse contacter lui-même le conducteur, ce qu’on lui refusa tout naturellement.
Obnubilé par son problème, et devenant de plus en plus paranoïaque, convaincu qu’il était d’être observé et surveillé par celui qui voulait sa mort, Paul se fit remarquer par l’extrême mauvaise qualité de son travail, et réprimandé en conséquence par son patron. Il n’en tint pas cas, et continua à passer soir et weekend à trouver un moyen de mettre la main sur son agresseur. A cette époque, le développement d’internet était trop limité pour obtenir des adresses et des contacts, ou même des indices ou des photos. Et son enquête personnelle piétina rapidement. A priori, le seul moyen qu’il avait de retrouver le propriétaire de la voiture était d’avoir des accointances dans la police, ce qui, dans ses relations n’était pas le cas, et dans sa famille, l’époux motard de la police d’une lointaine tante pouvait éventuellement l’aider, avec le risque d’y impliquer ses parents, ce qu’il voulait absolument éviter. C’est donc un peu la mort dans l’âme, fort de sa conviction que l’assassin passerait à nouveau à l’acte à son prochain anniversaire, qu’il se décida à attendre ce moment pour lui tendre un piège.
On ne vit pas bien lorsque l’on vit avec l’assurance que quelqu’un d’inconnu, parfaitement libre de ses mouvements, veut attenter à vos jours. Même si l’on se persuade que le forcené respectera son rituel savamment établi et effectuera sa tentative à une date précise, l’on sait qu’il se passe des choses en amont. On prépare son coup, et donc, on espionne sa cible, ses habitudes, on identifie ses points faibles, on visite ses lieux de prédilection, son appartement même, on fouille dans sa vie. Alors, lorsqu’on est la future victime et que l’on a conscience de ça, on sombre dans la plus profonde dépression paranoïaque. Début 2001, un petit mois avant la date fatidique, la pression émotionnelle fut trop forte pour Paul Carton. Il craqua. Cela se manifesta tout d’abord chez son employeur, où plus personne ne pouvait supporter la présence du jeune homme ni même travailler avec lui. Sans compter les terribles négligences dont il ponctuait son travail et qui lui valurent plusieurs avertissements. Sa mission s’arrêta, menée à terme avec difficulté grâce à l’intervention d’un autre employé faisant un meilleur travail, et son patron monta un dossier contre Paul pour le licencier. Du jour au lendemain, Paul se retrouva sans emploi ni indemnités et ne prit même pas la peine de saisir les Prud’hommes pour contester son éviction. Il accusa même ouvertement son patron d’avoir été payé pour lui pourrir la vie et partit en claquant la porte.
Reclus, Paul vécut ces dernières semaines chez lui comme un calvaire. N’ayant d’avance que de quoi payer deux mois de loyer et mangeant des pâtes chaque jour, Paul refusait également toute visite. Il osa même dire à William, inquiet pour lui, qu’il était un imposteur et qu’il n’ouvrirait pas sa porte. Son frère qui avait fait le déplacement depuis Paris logea donc à l’hôtel ce soir-là, et repartit le lendemain après une seconde tentative infructueuse de faire ouvrir l’appartement de son cadet délirant. William ne prévint pas ses parents, de peur que ceux-ci soient totalement affolé par la situation. Il préféra appeler Jean et Romuald pour leur parler du problème. Les deux aînés, inquiets, ne savait trop quoi dire. Par ailleurs, Paul restait injoignable au téléphone. Il avait rendu son téléphone mobile de société, et pour faire des économies, avait résilié son abonnement à France Telecom récemment estampillé Orange. Convaincus de devoir remonter le moral de leur jeune frère à l’approche de son anniversaire, ils se préparèrent à lui faire une surprise le jour dit. Mais le jour en question tourna au tragique. A Orléans, en ce jour d’avril 2001 si particulier, les frères Carton découvrirent, après avoir eux-mêmes enfoncé la porte de l’appartement, le cadavre de Paul.
Asphyxie au monoxyde de carbone, avait conclu l’enquête. Ce n’était pas surprenant. Dans un appartement dont les volets étaient complètement fermés, les fenêtres calfeutrées et les voies d’aérations bouchées, la cuisson au four, trop longue, d’un plat cuisiné avait dégagé suffisamment de gaz pour tuer le jeune homme alors installé dans un fauteuil devant sa télévision. La tristesse s’empara de la famille Carton. On enterra Paul Carton dans une concession familiale que les parents s’étaient achetés au cimetière d’Etampes en prévision de leur propre décès. Mireille et Jacques n’avaient pas envisagé une seule seconde qu’ils auraient à y mettre en terre leur plus jeune fils et bien des années avant qu’ils ne fussent assez vieux pour en avoir eux-même l’usage. Le deuil fut lourd à porter et personne dans la famille n’évoqua les circonstances dans lesquelles Paul était décédé, car cela aurait été admettre qu’il n’allait pas bien et que personne n’avait rien fait pour l’aider.
C’est Jean, l’aîné Carton, qui se chargea de régler les affaires de Paul. Il se sentait coupable d’avoir poussé indirectement son frère à la paranoïa. Lorsqu’il déménagea l’appartement tragique, il découvrit toute l’ampleur du mal dans les carnets de notes et la littérature de son cadet. Jean put ressentir la détermination incroyable de Paul dans cette croyance qui avait guidé la dernière année de sa vie. Il avait échafaudé des dizaines de scénario dignes des plus incroyables thrillers pour tenter de mettre un nom et une motivation sur sa Némésis inconnue. Sur chacune des personnes qui l’avaient côtoyé, tant dans le milieu professionnel que dans le privé, il avait établi un dossier, avait élaboré des hypothèses. Et il n’avait épargné personne, allant même jusqu’à soupçonner ses frères. Jean fut même choqué de lire que Paul avait pu supposer qu’il avait volontairement empoisonné sa famille pour le toucher lui. Jusqu’à un certain point, tout ce qui était écrit ici était aberrant. Mais Paul remarqua parmi ce fatras de délirantes allégations l’une des premières pistes suivie : la fameuse immatriculation.
Un mois après avoir mis en ordre les affaires de Paul, Jean avait repris le cours de sa vie. Mais il contacta un de ses amis qui était dans la police. Il lui demanda d’identifier le propriétaire du véhicule à la date d’avril 1999 où Paul avait été renversé, prétextant qu’il voulait avoir le cœur net sur la prétendue accidentalité du fait. Son ami n’en demanda pas plus. Il eut vite fait de trouver le dit propriétaire qui avait, comme par hasard, vendu le véhicule deux jours après l’accident. Le policier retrouva même l’adresse actuelle de l’individu, un homme appelé Eric Marchi, dont le nom ne figurait pas dans les fichiers de Paul. Le flic demanda à son ami s’il voulait qu’il intervienne dans le cadre d’une enquête officieuse, mais l’aîné Carton refusa. Il se rendit lui-même, à l’improviste, un soir après le boulot, au domicile parisien du sieur Marchi. Ce dernier vivait dans la banlieue parisienne, à Juvisy-sur-Orge. La ville avait changé depuis la naissance de Jean, mais de nombreux souvenirs d’enfance lui revinrent lorsqu’il se rendit chez Eric Marchi et il réalisa soudain que l’immeuble où l’individu logeait avait été le sien. La stupeur fut encore plus grande lorsqu’il se rendit compte que l’appartement auquel il allait sonner était également celui que les Carton avaient occupé.
Tout cela le plongea dans la plus grande perplexité et devant l’homme qui lui ouvrit la porte, il ne sut trop quoi dire.
– Bonjour monsieur, lui dit l’occupant au bout d’un moment. Que voulez-vous ?
– Heu… bonjour. Monsieur Marchi ?
– Oui, c’est moi. Que puis-je pour vous ?
– Je m’appelle Jean Carton. J’aimerai vous parler.
Eric Marchi, un homme ayant la trentaine, ne sembla pas réagir particulièrement. Il fronça légèrement les sourcils et demanda :
– Et de quoi au juste ?
– Puis-je entrer ?
– Non. Dites-moi d’abord de quoi vous voulez me parler.
– Du fait qu’un véhicule dont vous étiez propriétaire à renversé mon jeune frère Paul il y a de cela plus de deux ans.
– Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je pense que nous n’avons rien à nous dire, répliqua Eric en essayant de fermer la porte.
Mais Jean avait bloqué le battant avec son pied et poursuivit avec une certaine véhémence dans le ton :
– Et du fait que mon petit frère est aujourd’hui décédé après de multiples tentatives pour attenter à ses jours !
– Veuillez partir, insista l’autre en buttant à nouveau la porte contre le pied de Jean.
– Et je suis convaincu, pour habiter là où vous êtes, dans un appartement occupé jadis par ma famille, que vous n’êtes pas étranger à tout ça !
De colère, Eric prit de l’élan pour rabattre plus violemment la porte et Jean dut céder pour ne pas se faire écraser le pied. La porte claqua, résonnant violemment dans la cage d’escalier et laissant le père de famille ivre de colère sur le seuil. Il hésita à tambouriner à la porte et puis se ravisa en voyant un voisin de palier ouvrir la sienne pour voir ce qui se passait. Sans un mot, ni même un regard dans sa direction, Jean reprit le chemin de l’escalier et quitta son ancien immeuble.
L’affaire ne s’arrêta pas là. Le refus d’Eric Marchi à engager le dialogue n’était, selon Jean, pas seulement dû au fait qu’il avait perdu son sang-froid. La conviction qu’il avait de l’implication du bonhomme dans l’histoire de son défunt frère était viscérale. Et il s’employa à obtenir justice. D’enquêtes en enquêtes, et de procédure en procédure, Jean parvint à porter l’affaire du renversement devant les tribunaux. La démarche avait été rendue difficile surtout à cause de l’ancienneté des faits et l’absence de plainte de la part de Paul Carton, mais le témoignage des amis de William fut décisif pour obtenir une condamnation. Mais une condamnation ridicule au regard de ce dont Jean le pensait coupable. Eric Marchi reçut ainsi une peine de 2 ans de prison avec sursit et d’une amende de 40000 euros au titre d’indemnisation du plaignant. La famille Carton en fut bénéficiaire pour la moitié de la somme seulement étant donné que le principal intéressé était décédé. Mais Eric Marchi s’endetta pour payer son amende et ne fut pas davantage inquiété.
Si Jean ne comptait pas s’arrêter là, profitant de cette première victoire comme une preuve de la capacité du malfaiteur à porter atteinte à autrui, il manquait singulièrement d’élément pour engager d’autres poursuites. Et après trois ans de combat acharné pour en arriver là, l’aîné Carton n’avait ni les moyens, ni l’opportunité d’en faire plus sans se mettre lui-même hors-la-loi. Il tenta tant bien que mal de retourner à ses propres affaires et à sa propre famille. Convaincu d’avoir en parti vengé la mort de Paul sans pour autant en être vraiment satisfait. Durant cette longue période de procédure, il avait été soutenu par William et Romuald, mais ceux-ci n’avaient pas vraiment compris son combat.
En 2010, beaucoup d’eaux avaient coulé sous les ponts, et à ce moment seulement vint toute la lumière sur l’affaire. Jean reçut, vers la fin avril, la convocation d’un notaire parisien. Il en fut très étonné, car aucun motif précis de convocation n’avait été donné. Intrigué, il se rendit au rendez-vous et fut surpris d’être la seule personne présente à l’exécution testamentaire du client de Maître Jacob Serfaty. Ce dernier expliqua à Jean qu’Eric Marchi était décédé. Surpris, l’aîné Carton ne put s’empêcher de demander dans quelles circonstances :
– L’enquête de la police a conclu au suicide, lui répondit Jacob. Cela étant, il ne m’est pas autorisé par la présente de divulguer les détails de cette disparition. Je me dois simplement de vous lire cette lettre et dont je dois prendre connaissance en même temps que vous.
Jean se contenta de hocher la tête en attendant que le notaire procède.
– Avant de lire ce courrier, tel qu’il m’a été stipulé par monsieur Marchi, je dois vous révéler le contenu de cet extrait de dossier médical concernant mon client. Il y est fait état de divers compte-rendu de spécialiste sur le cas de monsieur Marchi. Comme vous le savez peut-être, la notion de mémoire absolu, ou eidétique, n’est pas reconnu par la médecine contemporaine. A ce titre, les problèmes de mon client avec ses facultés n’entrent dans aucune définition de pathologie connue. Divers spécialistes se sont succédés pour tenter de lui redonner une vie normale, mais son cas a été rejeté par la médecine traditionnelle, la neurologie et la psychiatrie. Il n’a reçu que des soins palliatif durant toute sa vie, mais rien pour le guérir, si tant est qu’il puisse être guérie de cela.
Maître Serfaty fit une pause et regarda son interlocuteur :
– Dois-je apporter des précisions sur le contenu de ce dossier ou puis-je continuer ?
– Si je comprends bien, Erik Marchi souffrait d’avoir une mémoire parfaite ?
– Nous lui préférerons le terme de « absolue ». Dans son cas, l’efficacité de sa mémoire n’est pas « parfaite ».
– Mais alors, de quoi est-il capable de se souvenir ?
– Ce qui semble être un problème dans son cas : de tout. Mais pas parfaitement. Mon client ne fait état de traitement médical sur le sujet qu’à partir de l’âge de 8 ans.
Jean ne voyait pas trop où ça menait aussi fit-il signe au notaire de continuer. Maître Serfaty décacheta alors la lettre mentionnée plus tôt et commença à la lire à haute voix :
– En date du premier avril 2010.
A cette date traditionnelle des canulars, Jean trouvait le clin d’œil de très mauvais goût. Il se fit cette réflexion sans interrompre Jacob :
– Je soussigné monsieur Eric Marchi, sain de corps et d’esprit, décide d’écrire ce courrier à l’attention de Maître Jacob Serfaty et Monsieur Jean Carton. Messieurs, Si vous lisez cette lettre, cela signifie que j’ai mis fin à mes jours et si je m’y suis bien pris, je suis décédé le jour de mon anniversaire, le 13 avril de cette même année.
Maître Jacob coupa sa lecture pour introduire un commentaire :
– Ce que je suis tenu de confirmer, monsieur Carton.
Jean était étonné de découvrir qu’Eric Marchi était né le même jour que son frère Paul. Mais la suite de la lecture lui révéla toute l’incroyable vérité sur les événements.
– Si j’ai décidé de me supprimer le jour de mon anniversaire, poursuivit le notaire, c’est dans l’idée que cela représente un symbole. Le symbole de ma naissance, certes, mais aussi, 38 ans plus tôt, le jour de mon premier souvenir à la Clinique Durieux.
Jean découvrait alors qu’Eric était né la même année que son petit frère et dans la même clinique. Jacob continua :
– C’est dans cette clinique, à la maternité, que j’ai fais la connaissance de Paul Carton, et que j’ai commencé à nourrir une profonde haine pour lui qui m’abreuvait de ses cris et pleurs et dont le souvenir m’a hanté nuit et jour durant 29 ans. C’est aussi de cette symbolique date dont je me suis servi pour tenter de tuer volontairement Paul Carton à plusieurs reprises, trois ans de suite, pensant naïvement que sa disparition m’ôterait le souvenir dérangeant de cette bruyante naissance. Ainsi procédais-je avec certaines choses que je désirais ardemment oublier, mais tuer un homme n’est pas aussi simple que de brûler une idée sur un papier. Je reconnais que je suis allé trop loin lorsque j’ai empoisonné toute votre famille, monsieur Jean Carton, pour arriver à mes fins. Et puis, comme par magie, ce souvenir a véritablement disparu un an plus tard, le jour de mes 29 ans. Et j’ai compris, en lisant la rubrique nécrologique d’un quotidien que monsieur votre frère était décédé, me délivrant véritablement de ses cris d’enfants. Jusqu’au jour de votre visite chez moi, je pensais naïvement que mes actes ne seraient jamais découvert. J’avais tort. Et si tôt fermée ma porte, le remord m’a étreint et ne m’a plus jamais quitté. Je me sens sincèrement responsable du décès de Paul Carton aussi sûrement que si j’avais moi-même poursuivi et réussi mon œuvre. Je pourrais payer pour les tentatives ratées d’homicide volontaire que j’ai commises, mais cela ne changerait probablement rien. Et finalement, votre frère continue de me hanter et je n’en serai délivré que par la mort, pas par la prison. C’est la raison pour laquelle j’ai mis fin à mes jours de cette manière, tout en vous informant de ce qui s’est passé et pourquoi. Comme je suis mort, il n’est pas nécessaire que vous m’accordiez votre pardon. De toute façon, je ne vous le demande pas, car j’estime que je ne le mérite pas. Je suis sans le sous, sans aucun moyens de rembourser une quelconque dette à l’heure actuelle et mes parents, la dernière famille qui me restait, sont décédés au début de l’année. J’ai épuisé mes ressources et mon énergie à résoudre mon problème dans une forme de vengeance cruelle et sans logique à vos yeux. Je vous épargne, peut-être tardivement, de vous livrer à la même quête que moi et vous apporte, je l’espère, un tout petit peu de satisfaction au travers de mes aveux et de ma disparation.
La vengeance est un plat qui se mange froid… Froid comme la tombe.
D'autres os à ronger
Tags: Les Ecrinautes, Pierre Bellemare
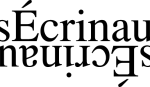



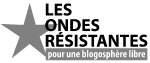


 On Flattre
On Flattre
3 commentaires pour le moment
Laisser une réponse